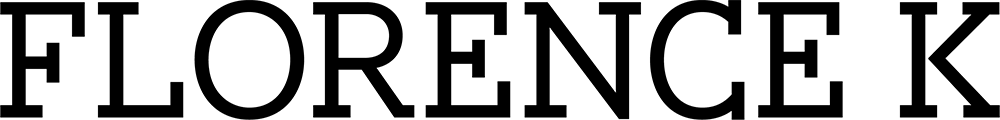LE TOUT QUE NOUS SOMMES
L’automne dernier, j’ai publié un livre dans lequel je raconte en long et en large mon expérience de la maladie mentale, plus précisément sur la façon dont l’anxiété et surtout la dépression ont failli m’avaler toute entière, il y a quelques années. Suite à la parution du bouquin, j’ai reçu des centaines de témoignages de gens qui avaient, eux aussi, vécu quelque chose de similaire. Ces messages m’ont évidemment beaucoup touchée et m’ont permis de constater à quel point la maladie mentale (que ce soit la dépression, l’anxiété, la bipolarité, le burnout, les troubles de personnalités limite ou les troubles alimentaires) affecte un nombre beaucoup plus élevé de gens que ce à quoi nous aurions tendance à nous attendre. Les statistiques le montrent clairement: plus d’un Canadien sur 5 aura à faire face à la maladie mentale un jour ou l’autre.
Parallèlement, pendant le tourbillon médiatique qui a suivi la sortie de mon livre, j’ai sans arrêt parlé publiquement des différentes étapes de mon incursion dans le monde de ce qui a communément été appelé depuis toujours la « folie ».
Coming out
J’ai un peu vécu ces moments-là comme un « coming out ». Il y a même un chapitre de mon livre qui se nomme de la sorte. Ce terme a vu le jour en 1869 lorsque l’Allemand Karl Heinrich Ulrich, qui défendait les droits des homosexuels, s’est rendu compte que l’invisibilité constituait un gros obstacle au changement de l’opinion publique et que le « coming out » était désormais une action nécessaire. Plus spécifiquement, un « coming out » désigne « l’annonce publique de toute caractéristique personnelle auparavant tenue secrète par peur du rejet ou par discrétion. » Et oui, jusqu’à ce que je ne me décide à écrire ce livre, j’avais eu, moi aussi, ma dose de crainte des préjugés. Mon livre et mon histoire ont reçu un accueil fantastique de la part du public et des médias et je me suis dit que j’avais fait la bonne chose en choisissant d’en parler ouvertement.
Sauf que, petit à petit, j’ai réalisé que de voir la sortie de mon livre comme un « coming out » allait à l’encontre de ma démarche. En effet, je voulais considérer celle-ci comme un pas de plus vers la normalisation de la chose, mon but n’étant pas de banaliser la maladie mentale, mais de faire en sorte que l’on soit capable d’en parler comme on parle aisément d’une maladie physique. Même si les mentalités sont beaucoup plus ouvertes qu’avant, les chiffres montrent bien que notre société a encore du terrain à gagner:
– Seulement 50 % des Canadiens diraient à des amis ou à des collègues qu’un membre de leur famille est atteint d’une maladie mentale, alors que 72 % parleraient d’un diagnostic de cancer. – 46 % des Canadiens pensent que les gens utilisent l’expression « maladie mentale » pour excuser un mauvais comportement.
Et pourtant, la dépression clinique est d’abord et avant tout une maladie qui puise sa source en divers endroits : dans les recoins de l’organe qu’est le cerveau, avec sa structure et sa chimie; dans l’organisation de nos schémas de pensée, façonnés par notre enfance, notre culture, notre éducation, nos expériences personnelles et nos traumatismes; dans l’impact des évènements qui se déroulent dans nos vies, dans notre environnement. Ce n’est ni un manque de volonté, ni une possession de notre esprit par le démon, ni de l’autocomplaisance, ni un moyen de rechercher de l’attention.
C’est entre autres pour tout cela que le « coming out » est un terme qui ne devrait plus être attribué là où l’on considère qu’il n’y a plus de tabous à avoir. Là où l’on ne devrait pas avoir honte de parler de ce que l’on est, de ce que l’on vit ou de ce que l’on traverse. Personne ne fait de « coming out » au sujet de sa pierre aux reins, de sa pneumonie ou de son cancer! Le tabou régnant encore sur la maladie mentale viendrait-il du fait que l’on croit encore que ceux qui en sont atteints seraient « responsables » de leur état? Qu’ils l’auraient choisi et donc qu’il y aurait un aspect « livraison d’aveux » à en parler ouvertement. Si oui, la croyance populaire est dans l’erreur et s’est depuis un bon moment faite complètement dépasser par la science.
« Staying in »
Il demeure que la décision de parler publiquement ou pas de soi est un choix très personnel. Ce n’est pas parce que nous sommes atteints d’une dépression ou d’anxiété que nous devons absolument raconter nos épreuves à voix haute, sauf, évidemment, dans le but de chercher de l’aide, car cette dernière est dans la plupart des cas nécessaire pour passer à travers et ne viendra pas à nous si l’on tait ce que l’on traverse. Mais reste que le « staying in » est une option tout à fait légitime. On peut garder ce que l’on vit pour soi. Sauf que si on décide d’en parler, on ne devrait pas avoir à le faire à voix basse en craignant d’être stigmatisé ou étiqueté.
J’irais même plus loin en avançant que dans un monde idéal, le fait d’en parler ouvertement ne devrait plus être vu comme un acte de courage, car nous sommes à l’ère où les préjugés devraient être choses du passé. Même si la maladie mentale n’est plus une affaire de Dieu et du Diable comme elle l’a longtemps été, il y a bel et bien encore du chemin à faire.
Le tout que nous sommes
Le tout que nous sommes est constitué autant de notre santé physique que de notre santé mentale. Non seulement le cerveau, siège de la santé mentale, est-il un organe, mais nos deux santés avancent ensemble main dans la main tout au long de notre vie. Lorsque l’une d’entre elles souffre, l’autre souffre aussi. La prochaine étape est donc de faire en sorte que le « coming out » n’en soit plus un. À ce moment-là, on pourra dire haut et fort que les préjugés sont réellement morts et enterrés.